

J’avais prévu de vous parler du Chantilly, un bar à pochetrons tenu par un ami à moi, qui se trouve être aussi le propriétaire de l’appartement que je loue. Son bistrot vient d’être visité par des flics mécontents sous prétexte qu’il sert à boire en dehors des heures légales à des soûlographes tricards partout ailleurs – trop bruyants, trop atteints, trop sales, trop bancals – qu’il leur sert à boire en dehors des heures légales et en plus les autorise à fumer à l’intérieur de l’établissement. Dix ans que ça dure et c’est la semaine dernière que ces bourriques décident d’aller y faire un tour à une heure et demie du matin pour constater – quelle surprise – que personne ne porte de masque, que tout le monde est ivre mort et qu’on peine à distinguer les visages à cause de la fumée de cigarette.
Je voulais vous parler de ça, évoquer quelques souvenirs liés à ce lieu de débauche à l’ancienne, vous faire aimer même les chiottes de ce troquet, alors que vous ne souhaiteriez pas les utiliser comme fosse commune pour votre pire ennemi ; finalement il sera question de roman de gare. Aucun rapport ? Faut voir.
À l’origine, comme son nom l’indique, le roman de gare ne se vend pas dans les charcuteries ; on le lit dans les trains le temps d’un voyage, sitôt acheté sitôt jeté. Collectionner ce genre de bouquin ne viendrait à l’idée de personne. Littérature strictement liée au marché, fabriquée pour distraire le lecteur sans le bousculer, longueur calibrée pour qu’en deux ou trois heures on en vienne à bout, langue suffisamment bouillie pour perdre toute saveur. Voilà pour l’ordinaire de la chose, que personne ne prend au sérieux. Les critiques se torchent avec, les gens de goût méprisent ce qu’ils appellent de la littérature de concierge (et ça en dit long sur la vaste quantité de vermine qui habite leur tête), les universitaires et autres historiens ne savent même pas que ça existe – ou alors en tant que phénomène social et économique et comptent les bouquins vendus plutôt que d’aller voir ce qui se cache à l’intérieur.
Autrement dit, la littérature de gare (la littérature pulp à la même époque aux USA) s’avère idéale pour accueillir les francs-tireurs qui cherchent une planque en-dessous des radars où produire leur œuvre. Dans cette zone située aux marges de la Kultur et inondant dans le même temps un large public, on trouve les véritables grands romanciers de notre siècle. Simenon. Malet. Hammet, Thompson, Goodis, Chandler, tous les quatre à la Série Noire, vaste pourvoyeuse. Et Lovecraft. Et toute la science-fiction des années 60, 70, 80. Au Fleuve Noir : Joël Houssin, Pierre Pelot, pour ne citer qu’eux. Et les goreux. Et les pornographes, Esparbec en tête. Tous les dingues et les tordus. Littérature de cassos, littérature de seconde, troisième zone. Littérature de pisseurs de copie, un roman terminé on enchaîne sur le suivant. Georges Simenon : notre maître à tous. Combien de bouquins, Simenon ? On ne sait même pas. Ça se compte en centaines. Peut-être trois cents, si on accumule tous ses pseudonymes – et encore, on ne les connaît pas tous. Et là-dessus, combien de chefs d’œuvre ? Trente ? Cinquante ? Davantage que Flaubert. Davantage que toute une équipe de foot de Flaubert.
Territoire au sol incertain, mouvant, qui peut se dérober à chaque pas. No-man’s land brumeux dédié au mauvais goût, aux mauvais genres, aux mauvaises vies. Pas de romans d’amour ambitieux et délicatement érotiques mais de la pornographie. Pas de fantastique de bon goût mais de l’horreur qui tâche. Pas de fictions subtiles à visée sociologique mais de la SF paranoïaque et de l’anticipation en roue libre. Pas d’énigmes criminelles mais du polar agressif et coriace – Chandler disait de Hammet qu’il avait « sorti le crime de son vase vénitien pour le jeter dans le caniveau ». Littérature de trottoir. De poubelles. De pissotière. De dépotoir. De cul de basse-fosse. De faubourgs (et plus tard de banlieue). Pas de psychologisme : de la viande avec une âme dedans.
Aujourd’hui le roman de gare n’existe plus, remplacé par une littérature populaire épurée de ses éléments subversifs. Guillaume Musso, Marc Levy et leurs confrères constituent le premier degré de cette littérature qui ne trouve sa force qu’à partir du second. Aucune contrebande chez Coben et Werber, c’est sûr. Où se planquent les pirates, alors ? Où trouve-t-on désormais la critique sociale, les idées tordues, les images délirantes, les scènes atroces, les personnages hors-normes ? Dans quels recoins humides doit-on chercher les champignons toxiques, hallucinogènes, empoisonnés ?
« La pornographie prolo et de mauvais goût éditée par Esparbec, mon maître, les fantasmes de bas étage déguisés en fausses confessions, les pharmaciennes lubriques et les patrons de bar vicieux touchaient dix mille, vingt mille lecteurs. Ils étaient l’antéchrist, bordel à cul ! Et se promenaient comme des loups au milieu des agneaux. »
Christophe Siébert
Voilà le paradoxe. Les désaxés avançaient masqués, cinquième colonne disséminée parmi la grosse cavalerie. Les cauchemars misanthropes et crados de Brussolo au supermarché et dans les kiosques des gares. Malet l’anar, Hammet le coco tiraient à trente, quarante, cinquante mille. La pornographie prolo et de mauvais goût éditée par Esparbec, mon maître, les fantasmes de bas étage déguisés en fausses confessions, les pharmaciennes lubriques et les patrons de bar vicieux touchaient dix mille, vingt mille lecteurs. Ils étaient l’antéchrist, bordel à cul ! Et se promenaient comme des loups au milieu des agneaux.
En 2020, les loups ont tous crevé, et les héritiers de Houssin, Pelot, Esparbec, Nécrorian, Simenon ne fréquentent plus les collections à très gros tirage, papier bas de gamme et encre qui tache les doigts. Par un renversement des choses, les francs-tireurs hantent les éditeurs indépendants, les intellos, les infréquentables, l’underground, l’avant-garde – ceux qui proposent des bouquins pointus, des tirages modestes, des couvertures pensées comme des œuvres d’art et draguent les lecteurs aventureux. On a sauvé les loups, en somme, en les parquant dans des réserves naturelles. Elles ont pour nom Au diable vauvert, Mu, La Musardine, Rivière Blanche, Les Forges de Vulcain, EquinoX, Nouvel Attila, etc. La littérature vivante est ici, désormais. Les loups sont parqués entre eux. Les agneaux bien pépouzes peuvent lire Gilles Legardinier, Michel Bussi ou Katherine Pancol sans que les détraqués de la fiction qui craint ne viennent les emmerder.
Du post-roman de gare. Du néo-roman de gare. Du roman de gare avec les qualités et les défauts de l’ancienne école mais un soin plus grand apporté à la fabrication, aux couvertures, au texte. Des livres que les lecteurs vont garder et relire, prêter peut-être, offrir pourquoi pas. Des livres destinés à des gens qui veulent mettre quinze balles dans l’achat d’un livre. Le prix d’un plat du jour là où l’ancien roman de gare valait plutôt un pain au chocolat.
Une littérature révolutionnaire existait dans les gares, les kiosques et les supermarchés. Elle n’y existe plus, remplacée par de la guimauve et du sucre. Ça s’appelle une contre-révolution. Le très grand public préfère Franck Thilliez. Ou alors, on le lui fait préférer : il n’y a jamais eu autant d’offre en librairie, mais dix auteurs captent cinquante pour cent des lecteurs, leurs livres empilés en têtes de gondoles, leurs têtes bonasses d’écrivains fréquentables placardées dans les couloirs du métro. La révolution est morte. Que reste-t-il ? De bons livres destinés – comme dit mon éditrice – aux classes moyennes cultivées, aux enfants de la crise, à ceux qui n’ont pour tout bagage qu’une poignée de diplômes et l’amour de la littérature. On a perdu les concierges, ils ou elles ne nous lisent plus. D’ailleurs les concierges ne prennent pas le train, le TGV est trop cher, les concierges voyagent en Flixbus – quand on leur en laisse le temps. Qui prend le TGV ? Les cadres et les classes moyennes. Nos lecteurs. Tout se tient et il ne reste plus qu’à se flinguer comme dans un film de Rossellini. Warren Buffet, ex-homme le plus riche du monde, l’a dit en 2005 : « Il y a une guerre des classes, c’est un fait. Mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. »
Malgré tout, de nouveaux éditeurs se lancent chaque année dans l’arène. Tentent le coup. Les cyniques prennent les paris : tiendra, tiendra pas ? Les idiots – dont je fais partie – applaudissent. Plus on est de fous. J’en ai repéré deux, cette année : Les Éditions du Typhon, basées à Marseille, dont je parlerai la prochaine fois, et Gore des Alpes, basées à Ardon, en Valais (Suisse), qui publient leur neuvième livre, Les Démons du Pierrier. Alors, avant d’avaler notre Martini-cyanure, lisons.
« Il est question d’un village tenu d’une main de fer par un curé obsédé par l’apocalypse et par l’idée que la modernité est l’instrument du Diable ; de paysans écrasés entre l’enclume de la trouille et le double marteau de l’ignorance et de la pauvreté. »
Christophe Siébert
Les Démons du Pierrier, de Jean-François Fournier, se passe dans la campagne suisse des années 50-60. Ambiance tendue, pesante, rurale et sordide. Il est question d’un village tenu d’une main de fer par un curé obsédé par l’apocalypse et par l’idée que la modernité est l’instrument du Diable ; de paysans écrasés entre l’enclume de la trouille et le double marteau de l’ignorance et de la pauvreté ; d’une jeunesse dont le désir d’émancipation se heurte à tous les murs imaginables ; de propriétaires terriens aussi riches que crasseux, brutaux et misanthropes ; de flics dépassés ; de violence contagieuse. Vous pensez à Maupassant ? Vous n’avez pas tort. Mais adapté par Roger Corman, alors. Nous voilà au cœur de ce que le roman de gare sait faire le mieux : aborder des sujets réels, importants, à travers une histoire de pure distraction qui sort l’artillerie lourde pour nous divertir. Sang, tripes, chiasse, foutre et autres accessoires du grand guignol se mettent au service d’un texte qui parle de la misère frappant tous azimuts le monde paysan en pleine décomposition et dresse le portrait de types perdus. Deux ou trois générations plus tard ils deviendront des zombies sans territoire, condamnés à hanter des bars comme le Chantilly dans l’espoir d’y trouver compagnie et chaleur – des bars où les honnêtes gens ne vont pas, devant lesquels ils passent en se pinçant le nez (puisque le signe de croix n’est plus à la mode). Des bars que les flics ferment parce que des sexagénaires aux poumons plus encrassés que la gazinière de Landru osent, tenez-vous bien, fumer dans la salle leur quarantième clope de la journée ! C’est peut-être tordu de ma part mais je veux croire que Jean-François Fournier, en écrivant ce roman-ci, rend hommage à ces types-là. Pas en leur cirant les pompes à la manière de Kervern et Delépine, « regardez comme c’est poétique et mignon, un pauvre, regardez comme c’est exotique et cocasse », mais plutôt en faisant d’eux les héros dégueulasses d’un récit dégueulasse – un récit dont la dégueulasserie rigolote, source d’amusement, permet de regarder en face la dégueulasserie bien triste et bien réelle du monde qui nous entoure.
Si vous aimez Le Beau Serge de Chabrol et Calvaire de Fabrice du Welz, si vous êtes curieux de découvrir une version alpine du Délivrance de John Boorman racontée du point de vue des tarés, si vous voulez lire une version dégénérée des Simenon qui se passe dans la campagne profonde, baladez-vous du côté du village dépeint par Fournier et rencontrez ses habitants. C’est un véritable jeu de massacre, au propre comme au figuré. L’auteur tape tous azimuts, et personne ne sort indemne de ce festival de lâchetés, de déviances, de cruauté et de bêtise. « Là où ça sent la merde, ça sent l’être », disait Artaud. Les Démons du Pierrier, livre par conséquent humaniste, se rapproche davantage du roman noir vachard et désaxé tel que le pratiquait le regretté Siniac (ou même A.D.G. dans ses meilleurs jours, cf. La Nuit des grands chiens malades) que d’un roman gore proprement dit. Néanmoins ce court texte (la collection a pour particularité de proposer des bouquins qui ne dépassent pas la centaine de milliers de signes, quand un roman ordinaire en fait le triple ou le quadruple) s’autorise quelques descriptions bien viandardes et assaisonne le tout d’une belle louche de cul dont la perversité vous réjouira – à condition que, comme il sied à tout homme de goût, vous considériez Les Diables de Ken Russel comme une excellente comédie familiale. Jugez plutôt!
« L’inspecteur principal décida de rejoindre le chef-lieu. Au village, il perdait son calme et se sentait perdu. Comme dans une tragédie grecque où le pouvoir et la violence engendrent le chaos et le déchaînement des plus bas instincts. La violence, ici, finissait par se confondre avec la laideur, l’injustice et le fantasme. D’ordinaire posé, et même rigoriste disaient certains, il avait bu tous les jours plus que son soûl, il avait insulté, méprisé, cédé à la colère ainsi qu’à des pulsions qui le laissaient glauque et hésitant. Tout avait commencé par une gifle à sa cadette pour un verre brisé. Et puis le ton était monté avec sa femme qu’il avait humiliée devant toute la famille. Ensuite de quoi il était sorti avec des desseins d’ivrogne et avait débarqué à l’improviste chez la fleuriste qui le regardait toujours avec des yeux de biche. Là dans l’arrière-boutique, il l’avait embrassée, ou plutôt mordue, bousculée sur la table de coupe où, malgré ses larmes, il lui avait enfoncé son bras jusqu’au coude avant de jouir petitement au-dessus d’un baquet d’eucalyptus, de fougère et de philodendron. Il était parti sans un mot pour la délaissée, avec l’impression qu’il avait trop bien retenu les leçons du Diable. Séduit par le mal, c’est ça, captif et ébloui devant la noirceur des âmes assombrissait la vallée du pierrier. “On devrait toujours laisser ces gens entre eux”, avait dit le Préfet. L’idiot ! Bien sûr qu’on devrait les placer en quarantaine ! Ils sont contagieux, leur violence est plus forte qu’un culte millénaire, leurs errances et leur pauvreté intellectuelle sont repoussantes et honteuses. Demain, il avait un rapport à rédiger pour le secrétaire du gouvernement. Qu’est-ce qu’on pouvait dire d’une enquête qui avait absolument tout d’un fiasco ? Que confier aux journalistes qui téléphonaient à présent de loin ? Rentré chez lui où les lumières étaient éteintes et où chacun dormait, il se masturba longuement au salon, entre la table et le guéridon, devant la reproduction trop colorée de La Naissance de Vénus de Botticelli. Ne sachant que faire de son sperme, il le mangea. »
Pour acquérir Les Démons du Pierrier, de Jean-François Fournier, il vous en coûtera 15 francs suisses. Ce qui équivaut, m’apprend Google, à 13,96 euros, 3039,27 roupies srilankaises ou 38 269,58 shillings tanzanien. Je me demande bien comment nous nous en sortirions sans Google.
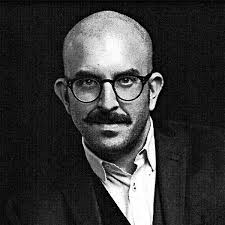
« J’ai toujours trouvé plus intéressant ces mondes culturels moins fréquentables. Il y vibre une énergie plus inspirante. »
Les histoires atroces du roman de gare vous fascinent. Spécialiste du genre, Christophe Siébert a rencontré pour Les Plus Belles Plumes un autre expert du gore: Philippe Battaglia, directeur de collection aux Editions Gore des Alpes.
Cher Philippe, la collection Gore des Alpes existe depuis un an et compte déjà neuf titres. Si j’en crois la présentation que tu en proposes sur le site, elle mêle horreur, sexe, humour et… terroir. Peux-tu nous en dire plus ? Est-ce qu’il s’agissait d’une volonté de départ de faire de la Suisse un nouveau territoire de l’horreur viscérale ?
La collection est née dans un contexte bien spécifique puisque c’était juste après les votations sur les Jeux Olympiques d’Hiver. Une période pendant laquelle les partisans du « oui » ont usé de tous les superlatifs possibles et imaginables pour rendre la Suisse merveilleuse à tous points de vue. Les initiateurs de la collection (trois à l’époque, cinq aujourd’hui) en ont eu un peu marre de cette carte postale de rêve et ont voulu montrer que notre pays, c’est aussi des choses plus sales, des lieux moins fréquentables, des zones d’ombre et, parfois, de non-droit.
À cela s’ajoute qu’habituellement, le fantastique ou, dans le cas présent, le gore nous viennent plutôt de l’étranger. Les USA et l’Angleterre se sont pendant longtemps taillé la part du lion, et les régions asiatiques s’offrent dernièrement une très belle percée. Une deuxième volonté de notre part était donc d’offrir un point de vue plus régional, avec des personnages, des lieux et des récits qui sont ancrés sous nos yeux. Les volumes déjà publiés nous ont prouvé qu’il y a ici tout ce qu’il faut pour faire de l’horreur. Quant au sexe et à l’humour, disons simplement qu’on apprécie le mélange des genres.
Quel est ton parcours ? Comment en vient-on à créer une collection consacrée à cette littérature ? Quels sont les auteurs qui t’ont servi de guide, de tuteur, de point de repère – s’il y en a – quand il a fallu définir la ligne éditoriale de ta maison ?
Tout d’abord, je me dois par honnêteté de dire que je ne fais pas partie des trois instigateurs de la chose. Je suis une pièce rapportée. Une fois l’idée germée, j’ai été contacté en raison de mes quelques expériences passées. Celles-ci n’ont en revanche que peu de liens avec la littérature. J’ai été pendant presque quatorze ans responsable de la programmation d’un festival à la Chaux-de-Fonds (2300 Plan 9 : Les Étranges Nuits du Cinéma), puis parmi les fondateurs de la salle obscure Le Kremlin, à Monthey en 2015. Si aujourd’hui, je ne suis plus en charge de ces deux postes, ils ont tout de même été un formidable terrain de jeux pour moi, pour partager l’une de mes passions qui est le cinéma étrange, parfois déviant, résolument autre. Mes références se situent plutôt du côté du cinéma d’exploitation US et des classiques de la Hammer british. J’ai toujours aimé ce côté parfois un peu cheap dont il ressort une sincérité à toutes épreuves. Si je devais donner une seule référence pour l’esprit cynique et sanglant du Gore des Alpes, je dirai Les Contes de la Crypte, la série tv qui m’avait tout simplement hypnotisé adolescent.
D’un point de vue plus personnel, mon expérience littéraire est très jeune puisque, si l’on fait abstraction de trois nouvelles publiées entre 2012 et 2016 (Le Jour des Cons, Sale Pute et Des Truies pour PiggyBoy, aux éditions La Puce, qui sont justement des hommages au cinéma précité), mon premier roman date de 2019 (Personne n’aime Simon, aux éditions L’Âge d’Homme). À l’heure où ces lignes sont écrites, La Fête de la Vicieuse est néanmoins mon quatrième roman en dix-huit mois.
La mythique collection Gore n’a existé que cinq ans (quatre au Fleuve Noir, un chez Vaugirard). Les éditions TRASH n’en ont duré que trois. Comment vois-tu l’avenir pour Gore des Alpes ? Dans quelles conditions économiques existe cette maison ? Est-ce que les libraires et les lecteurs sont au rendez-vous ? Est-ce qu’elle trouve sa place dans les salons consacrés aux littératures de genre ou de l’imaginaire ?
Nous nous sommes lancés dans cette collection avec une manière de faire un peu punk. On ne savait pas du tout comment ça allait prendre, ni même exactement comment faire pour y arriver. Mais comme nous sommes plutôt des gens dans l’action, on y est allé la fleur au fusil et ça a marché.
L’accueil médiatique et professionnel a été au-delà de nos espérances. Plus d’une librairie nous a confié recevoir nos ouvrages comme un bol d’air (un air un peu vicié, j’en conviens) dans une bulle littéraire romande souvent très homogène et, parfois, peut-être un peu ennuyeuse. Le fait est qu’à chaque nouvelle sortie, non seulement le nombre d’exemplaires vendus augmente, mais les commandes reprennent pour les ouvrages déjà publiés. Ceci, sans aucun doute, grâce en partie à l’effet collection et au travail fantastique de Ludovic Chappex, notre illustrateur.
J’ai trouvé que l’aspect général des livres (illustrations de couverture, etc.) les rattache à une esthétique underground, plus proche du fanzine que des maisons d’édition ayant pignon sur rue. C’est un choix de ta part ?
Totalement ! Comme je l’ai dit, nous avons une manière de fonctionner un peu punk. Il fallait que cela se reflète aussi dans les objets finis. J’ai toujours trouvé beaucoup plus intéressant ces mondes culturels moins visibles, moins fréquentables. Il y vibre une énergie tellement plus inspirante. À travers mes expériences ciné dont on a parlé plus tôt, j’étais déjà imprégné de ces codes-là, qui étaient aussi ceux qui me fascinaient quand j’étais môme. J’ai envie de retrouver cette sensation et qu’on puisse la partager avec nos lecteurs.
Je suis d’ailleurs très heureux de ton choix de mot. On est parfois appelé alternatif, ce qui était déjà le cas avec mes expériences dans l’événementiel. Je n’aime pas ce mot-là. Il sous-entend qu’il y a une vraie culture et une autre, qui serait secondaire ou moins noble. Je m’inscris en faux et je milite dans ce sens.
Tu es toi-même auteur de deux livres dans la collection que tu diriges. Comment passe-t-on d’une casquette à l’autre ? Te sens-tu plutôt un éditeur qui écrit, ou un auteur qui se lance dans l’édition ?
À vrai dire, ni l’un ni l’autre. J’ai toujours un peu de mal à m’identifier à ces rôles. J’ai participé à organiser des festivals, des soirées, des projections, des concerts ; j’écris des chroniques pour les journaux ou la radio ; aujourd’hui, j’écris des livres et j’en édite. Rien de tout ça ne me définit totalement et en même temps, tout fait partie de moi. Je vois plus ça comme des suites, des choses qui m’intéressent, qui me motivent, qui me stimulent, qui me nourrissent et, au bout du compte, qui m’aident à avancer et à devenir qui je veux être. Et qui m’amusent, bien sûr. C’est quand même la clé de tout.
Il convient tout de même de ne pas oublier que mon activité principale, celle qui paye mes factures, c’est courtier en immeuble. Ce qui surprend pas mal, d’ailleurs.
Quel genre d’éditeur es-tu, d’ailleurs ? Interventionniste ou plutôt du genre à publier le texte tel quel, avec ses imperfections éventuelles, afin de ne pas le dénaturer ?
J’ai tendance à laisser les gens travailler comme moi-même j’aime travailler. C’est-à-dire à laisser faire leur premier jet qu’on va revoir ensemble ensuite. Si les critères nécessaires pour remplir le cahier des charges de la collection sont remplis, alors il n’y a pas de retouches autres que les corrections. Si nous estimons qu’il manque un peu de ceci ou de cela, on en discute avec l’auteur. Des fois, ça se passe très bien, des fois, cela met malheureusement fin à la collaboration.
Nous avons un lectorat de niche, même s’il est vrai que nous nous sommes rendu compte, grâce aux différentes rencontres et dédicaces, qu’il est plus large que ce que nous pensions. Ce lectorat est fragile. Il est à la fois très demandeur et très exigeant. On ne peut pas se permettre de ne pas être sincère avec lui ou nous le perdrons. C’est pourquoi pour nous, la qualité de nos textes est primordiale. Dans l’absolu, l’histoire doit marcher sans le côté gore, sans artifice. Si c’est le cas, alors on peut tartiner à loisir et se faire plaisir, se défouler. C’est d’ailleurs ce qui ressort des discussions avec nos auteurs et autrices (publiés ou avec qui nous sommes en discussion) qui sont parfois un peu frileux au moment de démarrer et qui finalement nous remercient de leur avoir permis cet exercice.
Les livres que publie Gore des Alpes ne dépassent pas 120 000 signes. Pourquoi avoir choisi ce calibrage, inhabituel par sa brièveté ?
Dès le départ, nous avons opté pour ce format. L’idée était d’avoir des textes qui s’écrivent vite et qui se lisent vite, à l’image des romans de gare aujourd’hui malheureusement passés de mode. Nous voulions quelque chose qui se commence à Lausanne et se finit en arrivant à Sion (par exemple, hein, lisez-les où vous voulez). Le format papier est également très important pour nous. Aucun de nous n’est pour l’instant venu avec la volonté de les publier en e-book.
Effectivement, Gore des Alpes s’inscrit dans la tradition du pulp ou du roman de gare, tandis que les histoires ne s’enferment pas dans le gore « pur » et « dur » mais peuvent aussi se rapprocher, par exemple, du roman noir. Vous semblez attachés à cette impureté, à ce mélange des genres et des registres.
C’est évidemment vrai. Cela se fait aussi avec la sensibilité des auteurs, qui viennent tous d’horizons relativement différents. Les critères même de la collection donnent une homogénéité, mais les textes sont bien sûr très différents d’un livre à l’autre, raison pour laquelle on y trouve parfois un peu plus d’un certain genre ou d’un autre. Au final, le Grand-Guignol est tout de même très présent.
Le mélange des genres, comme dit un peu plus haut, est effectivement quelque chose que j’affectionne particulièrement, parce que cela permet aussi de briser les frontières et les codes, souvent assez précis, qui régissent tel ou tel genre. Par exemple, VenZeance, de François Maret, est un roman graphique. Certains auteurs avec qui nous sommes en discussion nous parlent de poésie ou de théâtre. Et pourquoi pas ?
Neuf livres par an, c’est un rythme plutôt soutenu !
Nous avons décidé de ce rythme infernal parce que nous souhaitions rapidement arriver à présenter une collection digne de ce nom. Aujourd’hui, si vous avez les neuf livres sur votre étagère, ça a de la gueule, notamment avec le dessin de tranche. C’est cela que nous voulions dès le départ. Si nous y arrivons, nous garderons ce rythme, mais peut-être que la cadence va ralentir. On ne sait pas encore, ça va tout simplement dépendre des manuscrits que nous recevrons. Tant qu’ils sont de qualité, on fonce.
Quels sont vos projets ?
Nos projets à court terme sont à l’image des cinq éditeurs de la collection et de nos auteurs. Variés et un peu foutraque. Nous avons comme objectif, maintenant que nous avons une masse intéressante à proposer, de sortir des frontières de la Suisse. Cela se fait déjà à petite échelle puisque nous avons des commandes de l’étranger.
Du côté des auteurs, nous avons quelques projets avec des noms de la littérature romande. Nous aimerions intégrer à notre équipe plus de femmes également. Et puis, nous commençons à recevoir des propositions d’auteurs français ou belges (même si le plat pays n’est pas réputé pour ses montagnes). Cela nous donnera un joli coup de projecteur et une dimension qui n’attend plus que nous.
Et comme on s’ennuie rapidement si on ne fait rien, certains parmi nous parlent déjà de traduction. Et même de sortir notre vin, le déjà légendaire Gore Boyaux.
Information sur le livre :
Les Démons du Pierrier, Fournier Jean-François, Gores des Alpes,
112 pages, ISBN 9782970135982

